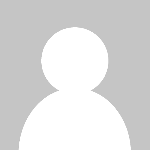Conseils supérieurs de la Magistrature en Afrique Francophone : Quels états des lieux pour quelles réformes ?


Au Cameroun
Une sortie au centre de controverses. Le 29 novembre 2024, le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République adresse une correspondance au ministre d’Etat, ministre de la Justice garde des Sceaux. L’objet de cette dernière vise la mise à disposition, pour emploi, des auditeurs de justice diplômés de l’Enam (Ecole nationale d’administration et de Magistrature, Ndlr) en attente d’intégration : « J’ai l’honneur de vous connaitre que le chef de l’Etat vous prescrit de mettre les auditeurs de Justice diplômés de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (Enam), pour emploi, auprès des Parquets d’Instance, en attendant leur intégration et leurs affectations définitives. »
La demande formulée par le secrétaire général de la Présidence de la République invite au questionnement. Sur la base de quel fondement juridique, le ministre d’Etat, ministre de la Justice Garde des Sceaux (Minjustice), Laurent Esso-peut-il ainsi agir-sans toutefois courir le risque-d’ENFREINDRE les dispositifs législatif et réglementaire en vigueur?
Il convient de rappeler qu’au Cameroun, le Conseil supérieur de la Magistrature (Csm) est régi par la loi du 26 novembre 1982 et son texte modificatif. Cet instrument normatif fixe et organise son fonctionnement: « Sont, en outre, soumis à l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature b) Les propositions —d’intégration dans la Magistrature, —d’affectation et de nomination des Magistrats du Siège dans les fonctions judiciaires, —les mutations des Magistrats du Siège- au Parquet ou des Magistrats du Parquet au Siège(…) » Ainsi dispose l’article 11 de la loi citée supra.
Les mêmes dispositions sont reprises à l’article 06 (1) du décret du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature : « Les nominations, mutations promotions, détachements, admission à un congé de maladie de longue durée, à la disposition ou à la retraite des Magistrats sont décidés par décret. » L’aliéna (2) de ce instrument règlementaire précise : « Les décrets de nomination de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires concernant soit un Magistrat du Siège, soit la mutation au Siège d'un Magistrat du Parquet, soit la mutation au Parquet d'un Magistrat du Siège sont soumis à l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature. »

Laurent Esso (à gauche), ministre camerounais de la Justice garde des Sceaux et Ferdinand Ngoh Ngoh (à droite), secrétaire général de la Présidence de la République
Dès lors, le ministre de la Justice, bien que membre du Conseil supérieur de la Magistrature, ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant d’accéder à la demande formulée par le secrétaire général de la Présidence de la République… A moins d’outrepasser les dispositifs législatif et réglementaire en vigueur.
Dans le même ordre d’idées, il convient de noter que les missions du Minjustice sont édictées par le décret du 18 septembre 2012, portant organisation du Ministère de la Justice. « Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux est responsable :
-De l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la nationalité, aux règles concernant les conflits de lois, au statut des Magistrats, à l’organisation et au fonctionnement de la Haute Cour de Justice, de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la Magistrature et à l’organisation judiciaire », prévoit l’article 1(2) du décret.
Le même dispositif réglementaire attribue au minjustice, la responsabilité de :
-l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique pénitentiaire ;
-Le suivi de la mise en œuvre de la politique pénale ;
-le suivi des droits de l’Homme et de la lutte contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
De plus, le ministre de la Justice assure le suivi des activités de formation des Magistrats, Greffiers, Avocats, Huissiers, Notaires… ainsi qu’à la discipline de ces corps de métier. Les attributions susmentionnées du Minjustice ne sont pas exhaustives.
Cependant, il importe de souligner qu’en l’état, aucune disposition du décret du 18 septembre 2012 portant organisation du Ministère de la Justice n’offre la possibilité au responsable de ce département ministériel, « de mettre les auditeurs de Justice diplômés de l’école nationale d’Administration et de Magistrature (Enam), pour emploi, auprès des Parquets d’Instance, en attendant leur intégration et leurs affectations définitives. » En conséquence, tout acte de nature à donner satisfaction à la demande formulée par le secrétaire général de la Présidence de la République est contra legem, et de fait, constitutif de l’infraction présumée de coalition contre les lois : « Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans, tout individu dépositaire de quelque partie de l’autorité publique et tout fonctionnaire qui, avec d’autres dépositaires ou fonctionnaires, concerte ou délibère :
-des mesures contraires aux lois ou aux textes d’application légalement pris...) », dispose l’article 124 (1) de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal.
Pourtant, le ministre de la Justice garde des Sceaux va tout de même se conformer aux « hautes instructions » du président de la République : « En attendant leur intégration et leur affectation définitive, les Auditeurs de Justice, diplômés de l’Ecole nationale d’Administration et de la Magistrature (division de la Magistrature et des Greffes-sections administrative, judiciaire et des comptes) des promotions 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022 et 2021-2023 dont les noms suivent, sont pour compter de la date de signature de la présente note de service, mis pour emploi, à la disposition des Parquets d’instances ci-après(…) » Peut-on lire dans la note de service N°013/DAG/MINJUSTICE du 13 décembre 2024.

Session du Conseil supérieur de la Magistrature au Palais de l'unité à Yaoundé au Cameroun/10/08/2020
Le CONTEXTE
Il convient de noter que la demande de mise à disposition des auditeurs de justice pour emploi près des Parquets d’instance intervient dans un contexte particulier. En effet, les auditeurs de justice diplômés de l’Ecole nationale d’administration et de Magistrature ne sont pas intégrés dans leur corps de métier depuis plus de 04 ans déjà au Cameroun.
Une situation qui est liée à l’irrégularité observée dans l’organisation des sessions du Conseil supérieur de la Magistrature. Cette instance est pourtant appelée à se réunir deux fois par an.
La représentation nationale n’est pas restée de marbre face à cette inertie. Ainsi, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice Garde des Sceaux, a été interpellé sur cette question. L’interpellation de Jean De Dieu Momo a lieu lors de son passage devant la Commission des Finances et du budget, dans le cadre de la défense de l’enveloppe budgétaire allouée à son département ministériel au mois de novembre 2024. Analysant les difficultés rencontrées dans le domaine de la Justice, les Parlementaires ont déploré notamment « -Le non-respect des délais statutaires impartis pour la tenue du Conseil supérieur de la Magistrature »
En rappel, la dernière réunion du Conseil supérieur de la Magistrature au Cameroun date du 10 août 2020. C’est à cette occasion qu’a eu lieu l’intégration dans le corps judiciaire des premiers auditeurs de Justice de la section COMMON LAW, sortis de l’école d’administration et de la Magistrature.
« Hautes instructions » et périls sur l’indépendance du pouvoir judiciaire ?
Les « hautes instructions » répercutées au ministre d’Etat, ministre de la Justice Garde des Sceaux remet au goût du jour, l’épineuse question de l’indépendance véritable du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif. L’analyse de la nature des rapports entre ces deux pouvoirs laisse transparaitre une relation d’assujettissement du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif.
La mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire peut se percevoir au travers de la place prépondérante qu’il occupe du sein du Conseil de la Magistrature Csm). Ce, eu égard aux missions dévolues au Conseil de la Magistrature, d’une part, et de la composition de cette instance d’autre part.
Et des missions du Csm
Le Csm représente l’instance qui décide du sort des Magistrats. Il nomme, PROPOSE l’INTEGRATION, AFFECTE, MUTE, PROMEUT, procède aux DETACHEMENTS, à L’ADMISSION A UN CONGE DE MALADIE de longue durée, à la disposition ou à la retraite des professionnels de ce corps de métier.
Cette mission est d’autant plus importante que le non-respect des délais impartis pour la tenue des sessions de cette instance ENTRAVE le cours normal du fonctionnement de l’appareil judiciaire. Le besoin en ressources humaines formées dans ce secteur d’activité, exprimé par le ministre secrétaire générale de la Présidence de la République dans sa correspondance en est la parfaite illustration.
En outre, il convient d’analyser la dépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif, à l’aune de la composition du Conseil supérieur de la Magistrature au Cameroun.

Et de la composition du Csm
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la République, responsable du pouvoir exécutif. De plus, « le Ministre chargé de la Justice en assure la Vice- Présidence. Toutefois, le Président de la République peut désigner une autre personnalité en qualité de Vice-président », dispose pour sa part, l’article premier(02) de la loi du 26 novembre 1982 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article premier de la loi suscitée, le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend en outre :
- a) trois députés désignés par l’Assemblée Nationale au scrutin secret, et à la majorité des deux tiers des membres la composant ;
- b) Trois Magistrats du Siège au moins du 4e grade, en activité de service, désignés par la Cour Suprême en Assemblée Plénière. « e) Une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée National, ni au corps judiciaire et n’ayant pas la qualité d’auxiliaire de Justice, désignée par le Président de la République, en raison de sa compétence. »
Observations
Il ressort des dispositions de l’article premier de la loi du 26 novembre 1982 fixant l’organisation et le fonctionnement du Csm que, le pouvoir exécutif contrôle la présidence et la vice-présidence de cette instance. Pour sa part, le pouvoir législatif jouit de la possibilité de désigner 03 membres. Ceux-ci sont élus à la majorité des deux tiers des membres la composant.
A cet effet, il n’est pas superflu de s’intéresser à la configuration politique actuelle de l’Assemblée nationale du Cameroun. L’Assemblée nationale est composée de 180 députés. Pour le compte de la 10ème législature, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir, dispose à lui seul de 152 députés (Hormis les élus décédés au cours de cette législature, Ndlr).
Le Rdpc est suivi de l’Union nationale pour la Démocratie et le Progrès -(Undp) (07) ;
-SOCIAL DEMOCRATIC FRONT (05 députés) ;
-Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn), 05 députés ;
-L’Union démocratique du Cameroun (Udc), 04 députés ;
-Le Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc), 03 députés ;
-Le Mouvement pour la défense de la République (Mdr), 02 députés ;
- L’Union des Mouvements socialistes (Ums), 02 députés.
Il ressort de cette configuration politique que le Rdpc est la formation politique qui bénéficie d’une majorité « obèse » à l’Assemblée nationale.
Cette majorité conduit de façon logique, au choix de ses partisans, pour occuper les statuts de membres du Conseil supérieur de la Magistrature. Un Conseil déjà présidé par leur camarade politique, le président de la République actuel, en charge du pouvoir exécutif.

« Il n’y a point encore de liberté si la PUISSANCE DE JUGER n’est pas séparée de LA PUISSANCE LEGISLATIVE et L’EXECUTRICE. » Montesquieu
Bien plus, les personnalités désignées pour composer le Conseil Supérieur de la Magistrature, sont nommées membres titulaires par décret. « En outre, le Président de la République peut inviter une ou plusieurs personnalités, en raison de leur compétence et de la nature du problème posé, à participer aux travaux du Conseil supérieur de la Magistrature. Elles ne prennent pas part aux délibérations. » Ainsi dispose l’article 03 (B) de la loi du 26 novembre 1982 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans le même sillage, il n’est pas superflu de convoquer les dispositions de l’article 6 de ce texte législatif: « Les personnalités non Magistrats, nommées membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, prêtent devant le Président de la République, lors de leur installation et avant tout acte de leur fonction, le serment prescrit pour les Magistrats dans le statut de la Magistrature. » Cette prestation de serment devant le président de la République prévue par la loi, est un symbole manifeste d’allégeance-de ceux qui sont supposés statuer sur le sort des Magistrats-à l’égard du patron de l’exécutif…
Ce paradoxe atteste de la violation du principe de la séparation des pouvoirs. Une violation étrangement consacrée dans les dispositions de l’article 37 (3) de la Constitution du 18 janvier 1996 : « Le Président de la République est GARANT DE l’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. Il nomme les Magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les Magistrats du Siège.»
Cette disposition de la Loi fondamentale laisse songeur : « Comment le président de la République, en charge du pouvoir exécutif peut-il véritablement garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, sans toutefois remettre en cause l’autonomie de ce dernier ? »
De l’avis de Montesquieu, la fonction d’exécution des règles élaborées par le législatif, relève du pouvoir exécutif, tandis que celle relative au règlement des litiges est dévolue au pouvoir judiciaire : « Il n’y a point encore de liberté si la PUISSANCE DE JUGER n’est pas séparée de LA PUISSANCE LEGISLATIVE et L’EXECUTRICE. » Ainsi, l’auteur de l’esprit des lois prévient : « Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature au Cameroun
Président du Conseil supérieur de la Magistrature : Paul Biya, président de la République, président du Rdpc ;
Vice-président du Conseil supérieur de la Magistrature : Laurent Esso, ministre d’Etat, ministre de la Justice garde des Sceaux, membre du Rdpc ;
Secrétaire général : Abel Minko Minko, Magistrat hors hiérarchie 01er groupe.
Personnalités désignées par l’Assemblée nationale :
-Alain Engelbert Essomba Bengono, député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir, circonscription électorale de la Mefou et Akono (région du Centre) ;
-Marlyse Toute Soppo, députée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la circonscription électorale du Wouri Centre (région du Littoral) ;
-Ali Mamouda, député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la circonscription électorale de la Bénoué Ouest (région du Nord).
Personnalité désignées par la Cour suprême :
-Mekoulou Cunégonde Christine ;
- Fofung Nabun Isaac Manga Moukouri ;
-Ntyam Ondo;
-Ernest Njumbe Njumbe;
-Oumarou Abdou.
Personnalité nommées par le président de la République :
-Amadou Ali (Ancien ministre de la Justice, décédé) ;
-Ekono Nna Albert.
Membres suppléants :
-Abe Mikhael Ndra, député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la circonscription électorale du Donga Mantum (région Nord-Ouest);
-Mariam Goni députée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la circonscription électorale du Logone et Chari, (région de l’Extrême-Nord) ;
-Rolande Adèle Ngo Issi députée du Parti camerounais pour la Réconciliation nationale (Prcn), de la circonscription électorale du Nyong et Kelle (région du Centre).

Le Conseil supérieur de la Magistrature dans les autres pays africains.
Le Conseil supérieur de la Magistrature exerce les mêmes fonctions que celles reconnues à cette instance au Cameroun. A effet, il procède aux nominations, propositions d’intégration, d’affectation, de mutation, de promotion des Magistrats.
De manière générale, il convient de noter que la configuration du Conseil supérieur de la Magistrature dans les 10 pays retenus dans le cadre de notre analyse, présente des points de convergence et de dissemblance.
Bien plus, la structuration de cette instance se démarque d’un pays à un autre, en raison des matières sur lesquelles l’instance est appelée à statuer.
La structure générale du Conseil supérieur de la Magistrature dans d’autres pays africains (Gabon, République démocratique du Congo (Rdc), Sénégal, Burkina Faso, Guinée Conakry, Bénin, Togo, Madagascar Egypte, Maroc)

Gabon
Article 3 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
La première vice-présidence est assurée par le Ministre chargé de la Justice.
La deuxième vice-présidence est assurée de façon rotative, pour une durée d’un an, par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.
Article 4 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend des membres qui ont voix délibérative et ceux ayant voix consultative.
Sont membres du Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix délibérative :
-le Président de la République ;
-le Ministre chargé de la Justice, Garde des Sceaux ;
-le Président de la Cour de Cassation ;
-le Procureur Général Près la Cour de Cassation ;
-le Président du Conseil d’Etat ;
-le Commissaire Général à la loi près le Conseil d’Etat ;
-le Président de la Cour des Comptes ;
-le Procureur Général près la Cour des Comptes ;
-les Présidents des Cours d’Appel judiciaires et les Procureurs Généraux près lesdites Cours ;
-les Présidents des Cours d’Appel administratives et les Commissaires Généraux à la loi près lesdites Cours ;
-les Présidents des chambres Provinciales des Comptes et les Procureurs Généraux près lesdites Chambres.
Sont membres du Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative :
-le Ministre chargé du Budget, dans les conditions prévues à l’article 71 de la Constitution ;
-trois Députés choisis par le Président de l’Assemblée Nationale, dans les conditions prévues par l’article 70 de la Constitution ;
-deux Sénateurs choisis par le Président du Sénat, dans les conditions prévues par l’article 70 de la Constitution ;
-un Président de Tribunal judiciaire ou administratif et un Procureur de la République ou un commissaire à la loi désignés de manière rotative par le Conseil Supérieur de la Magistrature pour une année judiciaire.
Article 5 : En matière de discipline des Magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé, de façon rotative, pour une année judiciaire, par les Présidents de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes. Il est composé :
-du Président de la Cour de Cassation ;
-du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
-du Président de la Cour des Comptes ;
-du Procureur Général près la Cour des Comptes ;
-du Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
-des Présidents des Cours d’Appel judiciaires, administratives et des Chambres Provinciales des Comptes, des Procureurs Généraux et Commissaires Généraux à la loi près lesdites juridictions ;
-d’un Président de Tribunal de première instance et d’un Procureur de la République ou d’un commissaire à la loi désignés pour l’année judiciaire en cours.
Article 6 : Dans l’accomplissement de ses missions, le Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté d’un Secrétariat Permanent.
Source : ordonnance N°011/PR/2021 du 06 septembre 2021 portant loi organique fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

République démocratique du Congo (Rdc)
Art.4.‐ Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de le République. Le Ministre de la Justice en est le premier vice‐président. Il peut suppléer le Président de la République dans la présidence des réunions du Conseil supérieur de la Magistrature.
Art.5.‐ Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend les membres de droit et les membres nommés par décret du Président de la République.
Le Ministre de la justice et le premier président de la Cour suprême en sont membres de droit, assurant respectivement la première et la deuxième vice‐présidence. Sont également membres de droit du Conseil supérieur de la Magistrature :
- Le Procureur général près la Cour suprême ;
- Le vice‐président de la Cour suprême ;
- Le premier Avocat général près la Cour suprême. Les autres Magistrats, nommés par juridiction par décret du Président de la République, sont :
- Un membre de la Cour suprême ;
- Trois membres des Cours d’appel ;
- Deux membres des Tribunaux de grande instance ;
- Deux membres des Tribunaux d’instance. Les membres non Magistrats, nommés par décret du Président de la République, sont :
- Un enseignant chercheur en droit de rang magistral ;
- Un psychologue et un sociologue, attestant chacun d’eux d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans ;
- Un représentant des organisations non gouvernementales (Ong) des droits de l’Homme. Est également admis à siéger au sein du Conseil en qualité d’observateur, un représentant du cabinet du Président de la République, chargé de suivre les activités du Conseil pour le compte du Président de la République, président du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Conseil supérieur de la Magistrature peut, enfin, sur décision de son président, et en raison de sa qualification, inviter une personnalité tierce, à prendre part aux assises du Conseil, à titre consultatif.
Art.6.‐ Les modalités de désignation des membres des juridictions ci‐dessus énumérés, procèdent de choix exprimés en Assemblée générale, sous la surveillance et le contrôle de la Cour suprême, et celles des membres non Magistrats le sont par leurs corporations respectives, sur la base du procès‐verbal de leur élection, transmis au Conseil supérieur de la Magistrature.
Source : Loi organique n°29‐2018 du 7 août 2018 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature

Au Sénégal
Article premier. - Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la Justice en est le vice-président.
Art. 2. - Sont membres de droit : le premier président de la Cour suprême et le Procureur général près ladite Cour ; les premiers présidents de Cours d’appel et les Procureurs généraux près lesdites Cours.
Art. 3. - Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend, en outre, quatre membres élus par les différents Collèges de Magistrats pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires quatre membres suppléants. Chaque collège élit en son sein un membre sauf le collège des Magistrats du deuxième grade qui a deux représentants.
Art. 4. - Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel.
Art. 5. - Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que l’organisation de son Secrétariat sont fixés par décret.
Source : Loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

Burkina Faso
Article 2 : Le Président du Faso est le président du Conseil supérieur de la Magistrature. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice est le premier vice-président et le premier président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION
Article 3 : Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend des membres de droit, des membres élus et des membres désignés.
Article 4 : Sont membres de droit du Conseil supérieur de la Magistrature :
- le Président du Faso ;
- le Garde des sceaux, ministre de la Justice ;
- le premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près cette juridiction ;
- le premier président du Conseil d’Etat et le Commissaire du gouvernement de cette juridiction ;
- le premier président de la Cour des comptes et le Procureur général près cette juridiction ;
- les premiers présidents des Cours d’appel et les Procureurs généraux près ces juridictions. Le secrétaire général du Ministère de la Justice et l’inspecteur général des services participent aux sessions du Conseil supérieur de la Magistrature avec voix consultative.
Article 5 : Les membres élus du Conseil supérieur de la Magistrature sont les représentants des différents grades de la hiérarchie judiciaire, à raison de trois pour chaque grade. Article 6 : Les membres désignés du Conseil supérieur de la Magistrature sont :
- trois représentants des organisations syndicales de Magistrats;
- une personnalité n’ayant pas la qualité de Magistrat ou d’auxiliaire de Justice, désignée par le Président du Faso.
Article 7 : Le président du Conseil supérieur de la Magistrature peut, en fonction de l’ordre du jour, inviter toute personne dont l’avis lui paraît utile à une session du Conseil.
Article 8 : Pour chaque membre du Conseil supérieur de la Magistrature, il est prévu un suppléant, à l’exception du président, du premier vice-président et de la personnalité désignée par le Président du Faso. Les présidents des juridictions supérieures sont suppléés de plein droit par les présidents de chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. Toutefois, le suppléant du premier président de la Cour de cassation ne le remplace pas dans sa fonction de vice-président. Les Procureurs généraux près la Cour de cassation, la Cour des comptes et le Commissaire du gouvernement du Conseil d’Etat sont suppléés de plein droit par les Magistrats du Parquet les plus anciens dans le grade le plus élevé au sein de leurs Parquets respectifs. Les présidents des Cours d’appel sont suppléés de plein droit par les vice-présidents de ces juridictions. Les Procureurs généraux près les Cours d’appel sont suppléés de plein droit par les Magistrats du Parquet les plus anciens dans le grade le plus élevé. Les suppléants des membres prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont élus ou désignés dans les mêmes formes et conditions que les membres titulaires.
Source : Loi organique N°049-2015/CNT du 25 août 2015 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature au Burkina Faso.

En Guinée Conakry
Le Conseil supérieur de la Magistrature, comprend dix-sept (17) membres dont quatre (4) membres de droit et treize (13) membres désignés par leurs pairs. Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux en est le vice-président.
Sont également membres de droit du Conseil supérieur de la Magistrature : - le Premier président de la Cour suprême ;
- le Procureur général près ladite Cour ;
Les treize (13) autres membres du Conseil sont : - Un premier président de la Cour d’appel désigné par ses pairs ;
- Deux (2) Magistrats de la Cour suprême élus en Assemblée générale de ladite Cour ;
- Un Procureur général près la Cour d’Appel, désigné par ses pairs ;
- Un (1) Magistrat de l’administration centrale du Ministère de la Justice, désigné par ses pairs ;
- Six Magistrats élus en Assemblée générale des Cours d’appel ; - Un président du Tribunal de première instance, désigné par ses pairs ;
- Un Procureur de la République désigné par ses pairs. Les membres de droit sont désignés eu égard au poste qu’ils occupent ; leur qualité fixe la durée de leur mandat et ils sont remplacés de plein droit dès la nomination de leurs successeurs.
Lorsqu’il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Premier président de la Cour suprême, à défaut par le Procureur général près la Cour suprême, à défaut de celui-ci par le Magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature, énumérés à l’article 4, sont élus par leurs pairs.
Source : -Loi organique L/055/CNT/2013 portant organisation, fonctionnement et autres compétences du Conseil supérieur de la Magistrature en Guinée Conakry.

Bénin
Article 1er nouveau: Le Conseil Supérieur de la Magistrature institué par l'article 127 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre l990 comprend :
a)- Les membres de droit
- Le Président de la République, président;
- Le Président de la Cour suprême, premier vice-président ;
- Le Garde des Sceaux, ministre chargé de la justice, deuxième vice-président;
- Les Présidents de chambre de la Cour suprême, membres;
- Le Procureur général près la Cour suprême, membre ;
- Un Président de Cour d'appel, membre ;
- Un Procureur général près une Cour d'appel, membre ;
- Le ministre chargé de la fonction publique, membre ;
- Le ministre chargé des finances, membre.
- b) Les autres membres
l0- Quatre (04) personnalités extérieures à la Magistrature connues pour leurs qualités intellectuelles et morales, membres ;
11- Deux (02) Magistrats dont un (01) du Parquet.
Les membres autres que ceux de droit, sont nommés par décret du Président de la République. La désignation du Président de la Cour d'appel ainsi que celle du Procureur général prévue aux points 6 et 7 du présent article est effectuée par tirage au sort.
Article 2 nouveau: Les deux (02) Magistrats prévus à l'article 1er point 11 sont respectivement désignés avec leurs suppléants. Les Magistrats titulaires et leurs suppléants sont désignés par l’Assemblée générale des Magistrats, parmi les Magistrats ayant ou moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.
Les personnalités extérieures à la Magistrature et leurs suppléants sont nommées sur une liste de sept (07) titulaires et sept (07) suppléants désignés par le Bureau de l'Assemblée nationale.
Source : loi N°2018-02 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi organique no 94-027 du 18 mars 1999 relative ou Conseil Supérieur de la Magistrature.

Togo
Article 1er
Conformément à l’article 116 de la Constitution, le Conseil supérieur de la Magistrature est constitué de neuf (09) membres :
-Trois (03) Magistrats de la Cour suprême ;
-Quatre Magistrats des Cour d’appel et des Tribunaux ;
-Un (01) député élu par l’Assemblée nationale au bulletin secret ;
-Une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée nationale ni à la Magistrature, choisie par le président de la République en raison de sa compétence.
Article 2
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la Cour suprême.
Article 3 : Les Collèges électoraux appelés à élire les membres du Conseil supérieur de la Magistrature, outre le Président de la Cour suprême et celui choisi par le président de la République sont constitués comme suit :
-Pour l’Assemblée nationale : L’ensemble des députés composant l’Assemblée nationale ;
-Pour les Magistrats de la Cour suprême : Tous les Magistrats en service composant ladite Cour.
-Pour les Magistrats des Cours d’appel et des tribunaux : Tous les Magistrats en service des Cours d’appel et des Tribunaux.
Pour ce qui concerne les Magistrats des Cours d’appel et des Tribunaux, la répartition est faite à raison de deux (02) pour les Cours d’appel et deux (02) pour les Tribunaux.
Source : Loi du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature au Togo.

Madagascar
Art. 2 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé ainsi qu'il suit :
- Le Président de la République, Président ;
- Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-président ; 3. Le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour ;
- Un Magistrat de la Cour Suprême représentant les trois Cours la composant élu en Assemblée Générale ;
- Sept Magistrats élus, dont cinq élus dans les ressorts des Cours d'Appel, un élu dans les Tribunaux administratifs et un élu dans les Tribunaux financiers.
Les Magistrats en service à la Chancellerie et les Magistrats détachés, ou mis à disposition, votent et sont éligibles dans le collège des Magistrats du ressort des Cours d'Appel. Les Magistrats sont éligibles dans le Collège où ils sont électeurs ; 6. Deux enseignants des Universités désignés par la Conférence des Présidents des Universités de Madagascar ;
- Une personnalité choisie hors de la Magistrature par une entité fédérative des organisations de la Société civile de Madagascar parmi les candidats proposés par les associations membres.
Art. 3 - Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature doivent être de bonne moralité et n'avoir jamais été condamnés. Les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ainsi que le conjoint ne pourront être simultanément membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Source : Loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil supérieur de la Magistrature en République de Madagascar.

Egypte
Le Conseil supérieur de la Magistrature égyptien est présidé par un Magistrat, le Président de la Cour de cassation. Ses autres membres sont le Président de la Cour d’appel du Caire, le Procureur général, les deux plus anciens vice-présidents de la Cour de cassation et les deux plus anciens Présidents des autres Cours d’appel
Source : (art.77 bis de la loi nº 35 de 1984).

Maroc
Selon l’article 86 de la constitution marocaine, le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi et se compose du ministre de la Justice, qui est le vice-président du Conseil, du premier Président de la Cour suprême, du Procureur général du Roi près de la Cour suprême, du Président de la première chambre de la Cour suprême, de deux représentants élus par les Magistrats des Cours d’appel et de quatre représentants élus par les Magistrats des juridictions de premier degré. Dans leur majorité, les membres du Conseil supérieur de la Magistrature marocain sont des Magistrats élus par leurs pairs.
Source : La loi du 11 novembre 1974 sur le statut de la Magistrature du Maroc régit les fonctions du Conseil.
L’analyse
La structure du Conseil supérieur de la Magistrature dans ces différents pays met en exergue, l’omniprésence du pouvoir exécutif au sein d’une instance consacrée à la gestion du personnel appartenant pourtant au pouvoir judiciaire. Au Gabon, en République démocratique du Congo (Rdc), au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée Conakry, au Bénin (Le président de la République assure la présidence du Csm, mais à l’exception des autres pays, le ministre de la justice n’occupe que la deuxième vice-présidence, derrière le président de la Cour de cassation.), le Maroc, Madagascar, la présidence du Conseil supérieur de la Magistrature est confiée au président de la République, responsable du pouvoir exécutif. La vice-présidence est dévolue au ministre de la Justice Garde des Sceaux, lui aussi relevant du pouvoir exécutif.
Par contre, les pays tels que le Togo, et l’Egypte font exception à cette règle. La conduite du Conseil supérieur de la Magistrature togolaise relève de l’office du président de la Cour suprême. En Egypte, cette fonction est dévolue au président de la Cour de Cassation, aux termes des dispositions de l’article 77 bis de la loi organique du Csm N°35 de 1984.
Il convient de noter que le président de la Cour de cassation égyptienne est nommé par le président de la République. Ce qui remet en cause son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif.
Sur les 10 pays africains en étude, seul deux pays, échappent à priori-à l’immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire- relativement au niveau de la présidence et la vice-présidence du Csm.
Il convient de noter que la configuration du Conseil supérieur de la Magistrature varie d’une part, suivant la matière sur laquelle il est appelé à statuer, et ce, en fonction du pays concerné.
En matière de recrutement, nomination et avancement
En République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de la Magistrature, comme Commission de nomination des Magistrats, propose au président de la République, la nomination des Magistrats du Siège et du Parquet des Cours et Tribunaux. « La liste des Magistrats à proposer est arrêtée par les membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature, sur présentation conjointe du premier président de la Cour suprême et du Procureur général près ladite Cour, sous réserve des arbitrages du Ministre de la justice. » Ainsi dispose l’article 08 de la loi du 7 août 2018 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature. « Lorsqu’il statue sur la nomination des Magistrats, le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République », prévoit l’article 8 de la loi du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sénégalaise.
Qu’en est-il du Burkina Faso ? La commission d’avancement se compose de l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la Magistrature à l’exception du Président du Faso et du ministre de la Justice. Aux termes des dispositions de l’article 25 de la du 25 août 2015 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, « la commission d’avancement est présidée par le premier Président de la Cour de cassation. »
En République togolaise, le recrutement de tout Magistrat se fait sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
Quid de la configuration du Conseil supérieur de la Magistrature en matière de discipline des Magistrats ?
En matière de discipline, le Conseil supérieur de la Magistrature burkinabè dispose de la même composition que la Commission d’avancement telle que prévue à l’article 24 de la loi organique du Csm. Il est présidé par le premier président de la Cour de cassation.
Ici, l’on observe une similitude avec la structuration du Csm en Rdc. En effet, le Conseil supérieur de la Magistrature comme Commission de discipline des Magistrats est présidé par le président de la Cour suprême : « Elles délibèrent tant à l’égard des Magistrats du Siège qu’à l’égard des Magistrats du Parquet de toutes les juridictions », prévoit l’article 21 de la loi organique du Csm. Il en est de même du Sénégal (article 10 de la loi organique du Csm) : « Le Conseil de discipline, statuant sur le cas d’un Magistrat du Siège, est présidé par le premier président de la Cour suprême.» Toutefois, « lorsqu’il statue sur le cas d’un Magistrat du Parquet, de l’administration centrale, en position de détachement ou de disponibilité, le Conseil de discipline est présidé par le Procureur général près la Cour suprême. »
Par ailleurs, le Conseil de discipline statue hors la présence du Président de la République et du ministre de la Justice. « Pour délibérer valablement dans ce cas, le Conseil de discipline doit comprendre, outre son président, au moins deux tiers de ses membres. »
Au Togo, le Conseil supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline des Magistrats du siège et du Parquet : « Il est saisi par le Garde des Sceaux. Les réunions ont lieu sur convocation du président de la Cour suprême », dispose l’article 23 de la loi organique du Csm.

« Ce ne sont pas les mensonges mais bien les remarques dont la fausseté est fort subtile qui retardent la réforme de la vérité », Georg Christoph Lichtenberg
Les axes de réformes
Le fonctionnement des Conseils supérieur de la Magistrature dans les Etats africains en étude laisse entrevoir la mise en œuvre des réformes. Ces dernières sont d’une importance capitale dans l’optimisation de son efficacité, en vue de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Les réformes préconisées se structurent autour de la composition des Conseils supérieurs de la Magistrature; des missions qui lui sont dévolues, en matière de nominations, affectations, mutations… La discipline, la formation des Magistrats.
De la composition
Le Conseil supérieur de la Magistrature constitue la « clé de voûte » de l’indépendance du pouvoir judiciaire. A cet effet, nombre de chercheurs militent en faveur d’une composition mixte de cette instance, « afin que celui-ci soit composé d’une majorité de juges élus par leurs pairs et de membres extérieurs à la fonction judiciaire et aux pouvoirs exécutif et législatif. »
L’avantage du recours à la une composition mixte du Csm est double. Il permet : « d’une part, d’éviter le corporatisme et d’autre part, de refléter les différents courants d’opinion de la société et apparaître ainsi comme une source supplémentaire de légitimation du pouvoir judiciaire»
Dans le même ordre d'idées, Ulrich Xavier Ovono Ondoua soutient la thèse de la reconfiguration du Csm. Pour le cas spécifique du Cameroun, « les parlementaires, devraient être exclus de ce Conseil. La séparation des pouvoirs l’exige. Dans une dynamique prospective, le Chef de l’Etat devrait cesser d’être Président du Conseil Supérieur de la Magistrature au profit du Premier Président de la Cour Suprême. » L’avis de ce Magistrat camerounais de profession s’exprime dans un environnement où l’évitement d’un gouvernement des juges par les défenseurs de la Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature par le Chef de l’Etat, est de mise ! « Cet argument audible se heurte quand même à la contemplation des autres systèmes institutionnels où, bien que le Chef de l’Etat ne préside point le Conseil, l’on n’a jamais assisté à un gouvernement des juges. » L’auteur de l’ouvrage sous les bandeaux de Thémis les larmes, Panser et repenser la justice camerounaise en veut pour preuve, le cas de l’hexagone : « En France par exemple, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Président de la République ne préside plus le Conseil Supérieur de la Magistrature. L’on n’y a pas vu s’installer un gouvernement des juges. »
En outre, Ulrich Xavier Ondoua milite pour le maintien à la vice-présidence Csm, du ministre de la Justice garde des Sceaux. De plus, il requiert en faveur de la prise ne compte des différentes catégories de Magistrats, allant du Magistrat du premier grade aux magistrats hors hiérarchie. « Cela permettrait d’avoir une approche réaliste des problématiques vécues au quotidien », soutient-il.

Du pouvoir de nominations, affectations…
Le Conseil supérieur de la Magistrature est appelé à protéger l’institution judiciaire de l’emprise de tout autre forme de pouvoir : « L’institution du Conseil supérieur de la magistrature répond à l’intention de retirer au Ministère de la Justice, une maîtrise exclusive sur les "mouvements’’ dans la carrière des Magistrats », souligne le Professeur Georges BURDEAU.
La compétence, l’intégrité, l’indépendance constituent le socle granitique de tout acte de nomination des Magistrats. « C’est pour limiter cette emprise des pouvoirs politiques sur les mouvements des Magistrats et par là, lever la suspicion de dépendance et de partialité dont ils seraient l’objet que le Csm est investi du pouvoir de garantir l’indépendance et la partialité des Magistrats, en émettant son avis sur les mouvements au cours de la carrière de ceux-ci », expose Bruno Djiepmou, doctorant en Droit public à l’Université de Dschang au Cameroun.
Dans cette dynamique, une étude intitulée : « Les conseils supérieurs de la Magistrature : Quelles réformes pour un pouvoir judiciaire indépendant ? Les exemples de l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Palestine » propose de « Prévoir dans la Constitution, l’existence d’une instance indépendante des pouvoirs exécutif et législatif, appelée ici Conseil supérieur de la Magistrature, compétente pour prendre les décisions se rapportant au recrutement, à la nomination, au déroulement de la carrière et à la cessation de fonction des juges. »
Bien plus l’article 9 du Statut universel du juge prévoit que «le recrutement et chacune des nominations du Juge doivent se faire selon des critères objectifs et transparents fondés sur la capacité professionnelle. Le choix doit être assuré par un organe indépendant comportant une part substantielle et représentative de Juges». Selon l’étude évoquée supra, la responsabilité de la sélection des Juges devrait incomber au Conseil supérieur de la Magistrature. « Celui-ci (Csm) doit agir selon des critères pré-établis, notamment par la loi, et se fondant sur les qualifications des candidats. »
De l’avis de l’auteur Ulrich Xavier Ovono Ondoua, « les actes liés à la mobilité des Magistrats devront être préparés, pour les Magistrats du Parquet, par le Ministère de la Justice et pour les Magistrats du Siège, par la Commission à créer au sein de la Cour suprême. » Ce Magistrat de profession se dit favorable à la « déconcentration » des tâches de mobilité, dans la mesure où elle « renforce l’indépendance du Juge dont l’inamovibilité devra être restaurée dans la loi envisagée, portant Statut de la Magistrature. »
Toutefois, cette différence suggérée dans le processus de nomination des Magistrats du siège et leurs collègues du Parquet ne rencontre pas l’assentiment de certains chercheurs : « Cette divergence de statut pose un problème. D’abord, ce manque d’alignement statutaire soulève des difficultés non seulement à l’analyse des exigences européennes, mais, tout simplement, au regard des exigences constitutionnelles », prévient d’entrée de jeu Bruno Djiepmou.
Pour ce dernier, le pouvoir judiciaire constitue le bouclier de la liberté individuelle. Il comporte aussi bien les Magistrats du Siège que les Magistrats du Parquet. Par conséquent, « il faut, en toute logique, que Siège et Parquet soient nommés de la même manière et d’une manière qui garantit également au Siège et au Parquet leur indépendance à l’égard de tous les pouvoirs. » Dans sa publication intitulée « L’organisation Du Conseil Supérieur de la Magistrature du Cameroun et la Protection internationale du droit à un procès équitable », Bruno Djiepmo renchérit : « (…) Ensuite cette divergence est troublante au regard de la dynamique de l’unité du corps judiciaire, qui permet notamment à un Juge de changer de qualité en migrant au Parquet et vice versa. »

De la discipline des Magistrats
Le Conseil supérieur de la Magistrature est également chargé d’adresser la question de la discipline au sein de la Magistrature. L’accomplissement d’une telle prérogative nécessite la mise en œuvre préalable-des mesures de protection-contre l’intrusion éventuelle des autres formes de pouvoirs : « Le contentieux disciplinaire des Magistrats doit se faire à l’intérieur du Conseil hors la présence du Chef de l’Etat qui pourrait prendre ultérieurement, les actes de sanction retenus par ledit organe », suggère Ulrich Xavier Ovono (Cas de la Rdc, Sénégal, Burkina Faso).
« Le manquement par un Juge à l’un des devoirs expressément définis par le statut ne peut donner lieu à une sanction que sur la décision, suivant la proposition, la recommandation ou avec l’accord d’une juridiction ou d’une instance comprenant au moins pour moitié des Juges élus», ainsi prévoit la Charte européenne sur le statut des juges.
En préconisant une composition constituée « au moins pour moitié des Juges élus », le législateur européen entend mettre en exergue la nécessité de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette préconisation commande le retrait du Ministère de la Justice, dans le processus du traitement des dossiers disciplinaires, dans les pays où l’intervention du garde des Sceaux est manifeste.
Par ailleurs, l’efficacité de l’instruction des dossiers disciplinaires invite la prise en compte du principe du double degré de juridiction. A cet effet, les Magistrats visés par une procédure disciplinaire auront la possibilité de contester les décisions du Csm, statuant en premier ressort, en cas d’insatisfaction : « Le contrôle juridictionnel des décisions du Conseil supérieur de la Magistrature garantit aux citoyens et au corps judiciaire en particulier, une meilleure protection de leurs droits. » Ainsi soutient l’étude sur le « Les conseils supérieurs de la Magistrature : Quelles réformes pour un pouvoir judiciaire indépendant ? Les exemples de l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Palestine. »

De l’extension des attributions du Csm
Il se dégage une convergence de vues sur l’impérieuse nécessité d’étendre le champ de compétences des Conseils supérieurs de la Magistrature dans les pays étudiés. En effet, le renforcement des pouvoirs des Csm participe de la volonté de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Cette indépendance articule l’autonomie financière et administrative des Csm. Les Conseils supérieurs de la Magistrature devraient disposer des ressources financières propres, indépendamment d’une ligne budgétaire attribuée au Ministère de la Justice. En conséquence, il importe d’« accorder au Conseil supérieur de la Magistrature la compétence de déterminer le budget du pouvoir judiciaire. »
Dans la même perspective, l’allocation d’un local propre, ainsi que des moyens techniques et logistiques, permettraient à cette instance de mener à bien ses activités.
En outre, l’étude sur le « Les conseils supérieurs de la Magistrature : Quelles réformes pour un pouvoir judiciaire indépendant ? Les exemples de l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Palestine» formule un ensemble de recommandations. Celles-ci visent à :
- Associer le Conseil supérieur de la Magistrature au processus de formation des Juges ;
- Confier au Conseil supérieur de la Magistrature la fonction de rédaction d’un code de déontologie judiciaire ;
-Informer le public des activités du Conseil supérieur de la Magistrature notamment par la publication de rapports d’activités réguliers ;
- Garantir la liberté d’association pour les Juges et leur reconnaître le droit de constituer des associations professionnelles. Cette analyse s'inscrit dans le cadre d'une reflexion plus étendue avenir.
Par Florentin Ndatewouo, journaliste chroniqueur judiciaire
Bibliographie
Sources législatives et réglementaires
-Le décret du 18 septembre 2012 portant organisation du Ministère de la Justice du Cameroun ;
- Le décret du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature.
-La loi du 26 novembre 1982 fixant l’organisation et le fonctionnement du Csm ;
-Loi du 02 juillet 2OI8 modifiant et complétant la loi organique no 94-027 du 18 mars 1999 relative au Conseil supérieur de la Magistrature du Bénin ;
-Loi organique n°29‐2018 du 7 août 2018 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo (Rdc) ;
-Ordonnance N°011/PR/2021 du 06 septembre 2021 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature du Gabon ;
-Loi du 25 août 2015 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature du Burkina Faso ;
-Loi organique L/055/CNT/2013 portant organisation, fonctionnement et autres compétences du Conseil supérieur de la Magistrature en Guinée Conakry ;
- Loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature du Sénégal ;
-Loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature de Madagascar ;
-Loi du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature du Togo ;
- Statut universel du Juge.
Autres documents :
-L’organisation Du Conseil Supérieur De La Magistrature Du Cameroun Et La Protection Internationale Du Droit A Un Procès Équitable, auteur : DJIEPMOU Bruno Doctorant en Droit Public Université de Dschang ;
- « Les conseils supérieurs de la magistrature : Quelles réformes pour un pouvoir judiciaire indépendant ? Les exemples de l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Palestine ».
Ouvrages :
-SOUS LE BANDEAU DE THÉMIS, LES LARMES
Panser et repenser la justice camerounaise, auteur : Ulrich Xavier Ovono Ondoua ;
-L’esprit des lois, auteur : Montesquieu
What's Your Reaction?
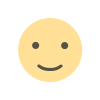 Like
0
Like
0
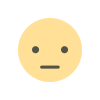 Dislike
0
Dislike
0
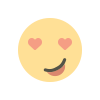 Love
1
Love
1
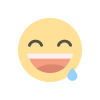 Funny
0
Funny
0
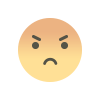 Angry
0
Angry
0
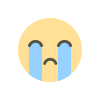 Sad
0
Sad
0
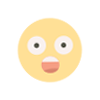 Wow
0
Wow
0